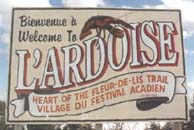|
L'Ardoise
est située sur la pointe nord-ouest du Cap-Breton en bordure
de la Baie Saint-Pierre.
Elle a reçu son nom de l'abondance des gisements d'ardoises sur
cette côte.
François Coste, un Français de Martigues venu en Acadie,
eut la permission de s'établir à cet endroit.
Il y fonda l' établissement de la Baie de l'Ardoise dont la pêche
était la principale activité.
Avec le temps, la population augmenta.
En 1720, il y avait 61 personnes dans le village de l'Ardoise. La plupart
de la population est venue de Louisbourg qui était en construction
depuis 1713, mais aussi de différentes parties de France.
Après la prise de l'Ile Royale par les Anglais, en 1758, l'Ardoise
resta une communauté française.
Les Anglais craigant le départ de ces pêcheurs performants,
leur donnèrent des garanties quant à leurs possessions.
La population, vivant de la pêche, était à la merci
des conditions climatiques, des fluctuations des prises saisonnières
et la plupart d'entr'eux ne pouvaient concurrencer les pêcheurs
étrangers qui opéraient avec des bateaux plus importants.
Tout ceci en
plus des problèmes liés à la domination anglaise,
rendait la vie dure aux pêcheurs et à leurs familles qui
devaient survivre toute l'année des gains accumulés pendant
la saison de pêche.
Vers 1780, des familles Samson, Pâté, Berthier, LaBaille,
Préjean, Longuepée, Briand, LaRue, Landry, Grassé,
Moubourquette, et Martell s'y sont installées.
La communauté de l'Ardoise était une mission d'Arichat
jusqu'à 1823. C'est alors que le Père Henry McKeagney
décide qu'il faut une église et un presbytère dans
la paroisse.
L'activité consistait à cultiver la terre, élever
du bétail ( moutons, poules, vaches etc...), à pêcher,
lorsque le poisson était en abondance. Les hâvres de l'Ardoise
étaient remplis de bâteaux et sur les côtes de petits
magasins furent construits pour approvisionner les pêcheurs. Les
femmes étaient là pour aider les hommes à préparer
le poisson quand les pêcheurs arrivaient ramenant de grandes quantités
En 1850 la première école ouvre ses portes à Bas-l'Ardoise.
Il y avait dix élèves, malgré un nombre de jeunes
enfants beaucoup plus important dans la paroisse.
En 1871, l'Ardoise s'est beaucoup developpée. Le recensement
dénombre 1495 habitants, la plupart vivant de la pêche.
Bien que les pêcheurs soient essentiellement acadiens, quelques
résidents d'origine irlandaise, écossaise et, pour très
peu d'entr'eux, anglaise, étaient concernés par cette
activité.
Cette communauté était très productive. En 1881,
elle comptait plus de bateaux pour la pêche côtière,
plus de pêcheurs, et disposait de plus de sondeurs, de filets,
de casiers qu'aucune autre communauté du comté de Richmond.
En relations avec la pêche, de nombreuses conserveries s'installèrent
à la fin des années 1800 et s'impliquèrent dans
la conservation des homards. Ces industries créèrent une
demande de proximité pour les pêcheurs locaux et employèrent
des hommes, femmes et jeunes de l'Ardoise.
Au milieu du vingtième siècle, le pêche continua
d'être la principale activité, mais avec beaucoup de problèmes.
Des pêcheurs interrogés en 1926 se plaignaient du manque
de ports bien amménagés, du prix élevé du
gas-oil et faisaient remarquer que le stockage et le transport du poisson
pourraient être améliorés. A cette époque
le poisson était vendu principalement à des acheteurs
locaux, bien que, de temps en temps, une compagnie envoyait un bateau
prendre un chargment de poissons.
Pendant la saison de pêche, toute la famille était, la
plupart du temps, sur le rivage. Le principal travail des femmes consistait
à faire sécher la morue. Morues, haddocks et maquereaux
étaient vendus à des marayeurs locaux qui possédaient
ou louaient des bateaux pour transporter le poisson à Halifax
ou aux Etats-Unis. La pêche aux homards, dans les années
30, n'était pas rentable car les intermédiaires, qu'ils
soient locaux ou distants, achetaient à bas prix. Aussi, seulement
quelques pêcheurs posaient des casiers à homards, la plupart
se contentant de vendre de la morue, du haddock ou des maquereaux aux
marayeurs locaux.
Avec le temps, la pêche aux homards devint une activité
plus rémunératrice, pendant que la pêche côtière
déclinait lentement.
En 1960, la pêche côtière, en général,
était en forte diminution concurrencée par les flottes
hauturières étrangères qui utilisaient des méthodes
de repérage et de capture plus performantes.
Aujourd'hui, en comparaison aux années passées durant
lesquelles 95% des hommes de l'Ardoise étaient pêcheurs,
seuelement un faible pourcentage de la population vit de cette activité.
|